Auteur : AFS
Cabinet syrien du 9 février 2013
Halab, Comment oublier Alep ?
Simone Lafleuriel-Zakri, auteur de multiples romans dont « la botaniste de Damas » et proche de notre Association, nous a fait parvenir son texte sur Alep où elle a vécu de nombreuses années. Il s’agit d’un témoignage personnel très émouvant que nous avons voulu vous faire partager /fichiers/pdf/halab-comment-oublier-alep-1-.pdf
Articles sur la Syrie
L’enseignement de la langue française en Syrie : témoignage.
« Rue des Syriens », de Raphaël Confiant
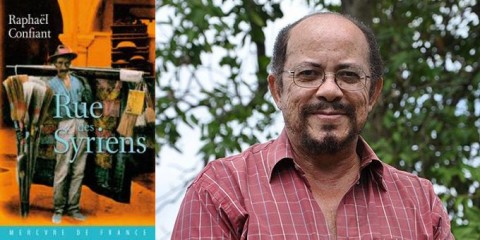
éditions Mercure de France
Dans son dernier livre, le romancier martiniquais Raphaël Confiant relate la saga des Syro-libanais en Martinique.
Le synopsis : À la fin du XIXe siècle, des centaines de milliers d’habitants issus des pays du Levant – Syrie, Palestine, Liban et Jordanie – émigrèrent en Amérique du Sud et dans l’archipel des Antilles. Ils furent désignés sous le nom générique de « Syriens ». Wadi est l’un d’eux. Quand il débarque à Fort-de-France dans les années 1920, le dépaysement est total. Il est à la recherche de son oncle Bachar, qui l’a précédé en Martinique au début du siècle. Wadi a tout à construire dans ce nouveau pays où il va vivre de multiples aventures et croiser de nombreux personnages : Fanotte la superbe et fantasque revendeuse, Bec-en-Or le crieur de magasin, Ti Momo le fier-à-bras amateur de combats de coqs, des maîtres en sorcellerie, un boutiquier chinois, un prêtre hindou, et bien d’autres encore, caractéristiques du melting-pot antillais…
L’archéologie a l’honneur
Des conférences ayant pour thème la présentation des multiples sites et aspects de l’archéologie syrienne sont régulièrement organisées tous les mois par le Centre Culturel Arabe Syrien.
Citons pour mémoire la tenue depuis le début de cette année des conférences suivantes :
– Conférence le 10 janvier 2012 de Mme Béatrice Muller, Directeur de recherche au CNRS, UMR 7041 ArScAn, Archéologies et Sciences de l’Antiquité – Nanterre, sur le thème «La peinture murale en Syrie et en Mésopotamie (du IVe au Ier millénaire av. J.-C.)».
– Conférence le 31 janvier de M. Eric Coqueugniot, Directeur de recherche au CNRS, Responsable de la fouille de Dja’de, qui a traité de « Dja’de el Mughara, un village du 9ème millénaire avant notre ère en Syrie (Vallée de l’Euphrate) ».
Le néolithique apparaît au Moyen-Orient, notamment dans le nord de la Syrie, avant l’Europe. On assiste selon des étapes successives à la naissance des divinités, à la sédentarisation, à l’agriculture, à l’élevage, puis à la céramique. La question de la domestication des plantes, des animaux et de la sédentarité est évoquée. On a notamment découvert des figurines féminines avec la symbolique du taureau, des figurines féminines et des figurines asexuées, ainsi que des petites haches en céramique, des poignards et des flèches en silex. La découverte également d’une sépulture de 70 individus « maison des morts », sans offrandes ni objets est ensuite relatée.

Entre steppe syrienne et Djeziré, Europos-Doura marque de sa forte présence le paysage avec ses murailles remarquablement conservées et ses ruines qui dominent l’Euphrate du haut d’une falaise de quarante mètres.Située entre Deir ez Zor et Al Boukamal, elle a été fouillée depuis 1920 par trois missions archéologiques successives qui y ont dégagé de nombreux monuments et ont révélé l’un des sites archéologiques les plus prestigieux de la Syrie antique. Définitivement désertée en 256 à l’issue d’un siège acharné par les Sassanides, elle n’a jamais été réoccupée. C’est ainsi qu’ont été remarquablement préservés ses monuments et qu’y ont été découverts de nombreux documents illustrant la vie de cette période. Ceci en fait la source majeure de l’histoire du Proche Orient grec, parthe et romain. Ses peintures, dont certaines ont été récemment découvertes, sont particulièrement célèbres et lui ont valu d’être appelée « La Pompéi du désert ».
– La réunion le 27 mars sous le titre de : « La Syrie antique, terre des reines » a donné lieu à deux présentations distinctes :
– « Les reines de Syrie aux IIIe et IIe millénaires av.J.C. » par Mme Brigitte Lion, Professeur d’histoire ancienne à l’Université François Rabelais, Tours.
Si en Syrie, les femmes n’exercent pas la réalité du pouvoir politique aux IIIe et IIe millénaires av.J.C., les femmes de la famille royale jouissent d’un grand prestige et exercent des fonctions administratives importantes. La mère du roi bénéficie d’un statut élevé, son épouse principale est informée de la situation politique et joue un rôle majeur dans la gestion du palais, ses filles contribuent à la création de jeux d’alliances par le biais de mariages diplomatiques. Les archives des palais d’Ebla, de Mari et d’Ougarit permettent d’étudier cette place remarquable des femmes pendant plus d’un millénaire, du XXIV au XIIIe s.av.J.C.
– « Zénobie : de Palmyre à Rome » par Mme Virginie Girod-Drost, Docteur en Histoire de l’Université Paris IV-Sorbonne.
Zénobie (267-273), la reine des reines, est un personnage emblématique de la Syrie antique. Par son ambition et son habileté, elle s’est imposée sur la scène politique romaine de laquelle les femmes étaient généralement exclues. Zénobie, comme les autres impératrices syriennes, à l’instar de Julia Domna, a affolé les chroniqueurs de l’Histoire Auguste qui lui ont consacré un chapitre complet dans le livre des Trente Tyrans. Reine orientale, elle devint, sous la plume des historiens romains, une nouvelle Cléopâtre.
Le Liban et la Syrie au miroir français (1946-1991), par Marie-Thérèse Oliver-Saidi
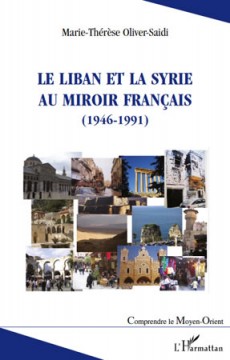 Marie-Thérèse Oliver-Saidi, Agrégé de Lettres classiques, Docteur d’Etat ès Lettres et Sciences humaines a passé plusieurs années au Moyen-Orient (Liban, Egypte, Turquie), y exerçant diverses responsabilités au sein du ministère des Affaires étrangères.
Marie-Thérèse Oliver-Saidi, Agrégé de Lettres classiques, Docteur d’Etat ès Lettres et Sciences humaines a passé plusieurs années au Moyen-Orient (Liban, Egypte, Turquie), y exerçant diverses responsabilités au sein du ministère des Affaires étrangères.
Elle a présenté son livre « Le Liban et la Syrie au miroir français (1946-1991) », paru récemment aux Editions l’Harmattan (www.editions-harmattan.fr), le 23 février dans le cadre du Séminaire « Orient, littératures contemporaines », animé par Gilles Ladakany et Rania Samaria à l’EHESS, 96, bd Raspail à Paris.
Après une description des effets du mandat (1920-1946) sur les populations de la Syrie et du Liban, l’auteure s’est penché sur les événements politiques intervenus dans les deux pays et qui ont jalonné la période 1946-1991.
Elle analyse ensuite l’image d’un pays tel qu’il est perçu par un autre et comment cette image dispose de nombreuses facettes culturelles et économiques lesquelles influencent à leur tour la politique et la diplomatie.L’image est souvent façonnée par divers groupes de pression (pèlerins, religieux, journalistes, hommes d’affaires, médiateurs etc.) qui peuvent avoir un relais positif ou pas.
En l’occurrence, les représentations de ces deux pays ont connu en France, de leur indépendance en 1946 à la guerre du Golfe en 1991, des évolutions aussi importantes qu’inattendues.
Enfin, Mme Oliver-Saidi a conclu sa présentation en émettant le souhait que la situation actuelle puisse offrir de nouvelles perspectives aux relations franco-syriennes en particulier, et que la Syrie soit enfin abordée pour elle-même et non plus à travers le prisme libanais.
Le gel des avoirs syriens
Par Me Fabrice Marchisio, Avocat d’affaires, Barreau de Paris.
(Conférence 22 février 2012)
Ces dernières années, certains Etats ont vu leurs avoirs à l’étranger gelés par une décision de l’ONU :Iran, Birmanie, Corée du nord, Zimbabwe, Yougoslavie, et pour les pays arabes, Irak (1993), Soudan (2003), Egypte (2011).Depuis le début 2011, les sanctions (59) contre les personnes ont augmenté ; celles contre la Syrie n’ont pas été votées à cause des vetos russe et chinois à l’ONU. L’Union européenne a alors appliqué des sanctions contre la Syrie selon un calendrier évolutif à partir de mai 2011 ; les premières mesures ont frappé la famille présidentielle, les membres du Gouvernement et les personnes ou compagnies soutenant financièrement le Régime ; les services prodigués aux forces armées et à la police syriennes ont été interdits.
En septembre 2011, sont interdits l’exportation et le transport de pétrole syrien et l’importation de pétrole en Syrie,
En octobre 2011, interdiction de participer à l’exploration de pétrole,
En novembre 2011, interdiction d’utiliser des devises syriennes et d’exporter vers la Syrie du matériel informatique ou du matériel de contrôle de l’informatique,
En décembre 2011, interdiction de raffiner du pétrole syrien et d’exporter vers la Syrie tout matériel destiné aux centrales électriques,
En mars 2012, interdiction d’acheter des diamants en provenance de Syrie et interdit aux cabinets-conseils étrangers de faire des recommandations orales ou écrites à des sociétés syriennes.
Parution d’un roman historique
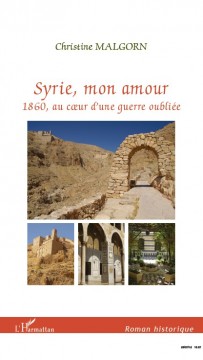 « Syrie, mon amour. 1860, au cœur d’une guerre oubliée », roman historique de Christine Malgorn, paru chez l’Harmattan (29€).
« Syrie, mon amour. 1860, au cœur d’une guerre oubliée », roman historique de Christine Malgorn, paru chez l’Harmattan (29€).L’histoire est-elle condamnée à se répéter ? Une fois encore on s’aperçoit que derrière la défense d’une noble cause, se cachent des enjeux politiques et économiques. C’est ainsi que sur un arrière-fond de rivalité franco-anglaise pour la domination de la région soumise encore à l’autorité vacillante du Sultan ottoman, que ces événements vont provoquer l’intervention d’un corps expéditionnaire de huit mille hommes de l’Empereur Napoléon III, qui débarque à Beyrouth en août 1860. Parmi ces soldats figure Pierre, héros du roman, qui découvre l’orient.
Au-delà de la trame romanesque, la lecture de ce livre nous livre de précieuses indications sur l’origine des conflits qui ont ensanglanté la région à cette époque ainsi que des descriptions détaillées de la vie socio-économique de ses habitants.
Les conséquences du système des capitulations étrangères sont décrites dont l’existence des Consulats à Damas, qui quel que soit le pays représenté, jouaient le rôle d’un état dans l’Etat au détriment de la paix entre les communautés musulmane et chrétienne. Les agents consulaires se transformant en commerçants spécialisés dans la vente des protections lesquelles permettent à leur tour à celui qui en est détenteur, de disposer d’un statut d’extra-territorialité et d’échapper à l’impôt dû au Sultan.
Les textiles des manufactures européennes qui ont commencé à se déverser en 1840 en Syrie ont fait disparaître des milliers d’artisans et de tisserands de Damas et d’Alep. Les métiers à tisser n’ont pu lutter contre l’entrée de ces productions industrielles.
Le livre contient une description des souks de Damas (souk des selliers, artisans, tissus et Caravansérail Assad Pacha) ainsi qu’ une représentation des karakaguez, semblables aux guignols actuels qui jouent un rôle dans la propagation des rumeurs.
L’action des hommes de l’Emir Abdel Kader le 10 juillet 1860 pour assurer le sauvetage des chrétiens lors de ces événements y est rappelée.
Le rôle de Fouad Pacha, Emissaire du Sultan ottoman qui instaure une punition exemplaire en procédant à l’exécution des responsables ottomans du massacre de Damas est soulignée ainsi que ses rapports avec le Général de Beaufort, Chef du corps expéditionnaire.L’origine des événements qui ont opposé les Chrétiens et les Druzes au Liban serait due en partie aux hommes d’église maronite et aux luttes de pouvoir entre cheikhs et religieux druzes et maronites.
L’entrée en scène d’un parent du personnage principal Pierre dans le roman, journaliste anticlérical, qui joue le rôle d’informateur permet d’éclairer le point de vue des druzes dans le le déroulement des luttes avec les maronites. Afin de contrecarrer le soutien apporté par la France aux maronites, les druzes pactisèrent dès lors avec des missionnaires protestants.
Soulignons également , l’épisode du bref passage de Pierre dans la Ville de Zahlé dans la Békaa et sa rencontre avec le père Paolo qui lui apporte un certain apaisement. Cette ville enrichie par le commerce de la soie et où l’on voit y éclore la production de vin y est décrite comme « une République théocratique », la religion catholique était érigée en religion d’Etat, soustraite de ce fait à l’autorité ottomane. Huit mille druzes iront par la suite à l’assaut de Zahlé sous la férule de Khattar Al Imad.
La Culture du mûrier à Deir El Qamar et dans la région du Mont-Liban incitera les industriels de Lyon à créer de multiples de filatures de soie. Le développement de l’industrie de la soie en Syrie devient dès lors un enjeu économique pour la France.
MA